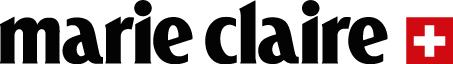Toutes les deux semaines, une femme meurt tuée par son mari, son (ex-)partenaire, son frère ou son fils en Suisse. C’est ce que révèle l’association Stop Feminicide.

« Les féminicides n’arrivent pas par hasard » — Pierre-Antoine Hildbrand
Afin d’enrayer la spirale qui mène à ces féminicides, la police lausannoise s’est dotée, depuis juin 2022, d’une Unité spéciale pour la prise en charge des victimes de violences domestiques. Objectif: assurer un suivi et une action préventive.
Une hausse préoccupante des violences
Vingt-trois femmes et filles sont décédées des conséquences de la violence domestique en Suisse depuis début 2025. C’est 21% de plus que l’année passée, qui comptait 19 victimes de féminicides au total. «Les féminicides n’arrivent pas par hasard, souligne Pierre-Antoine Hildbrand, conseiller municipal de la Ville de Lausanne en charge de la Sécurité. Nous nous devons de travailler au plus haut niveau tout au long de la chaîne sécuritaire afin de prévenir ces risques au maximum.»
Alors que le Bureau fédéral de l’égalité entre les femmes et les hommes indique une augmentation de la violence envers les femmes depuis quelques années (+6% entre 2023 et 2024), l’Unité spéciale de la police lausannoise constitue pourtant une structure quasi inédite en Suisse: «Beaucoup d’outils juridiques existent, mais l’ambition et les moyens financiers pour les réaliser peuvent parfois manquer. Il aura par exemple fallu cinq ans entre l’annonce et la mise en service d’un numéro de téléphone à trois chiffres pour l’aide aux victimes, d’ici mai 2026.»
Suivi et travail collaboratif

Dirigée par l’inspectrice principale Albane Bruigom, l’Unité spéciale de la police lausannoise a suivi plus de 250 victimes de violences domestiques, de litiges ou de harcèlement obsessionnel (ou stalking) depuis début 2025. «Notre travail concerne exclusivement les couples sans distinction de genre, qu’ils soient ensemble ou séparés, mariés ou non.» Dans la majorité des cas, un suivi est mis en place à la suite d’une intervention de la police au domicile ou dans l’espace public.
Les victimes sont contactées par téléphone. «Mes deux collègues et moi-même nous assurons qu’elles aient bien compris la procédure – autrement dit leurs droits – et qu’elles sachent où trouver de l’aide. Nous les orientons parfois vers un avocat. Notre rôle consiste aussi à répondre à leurs inquiétudes et à leur apporter un maximum de conseils pour garantir leur sécurité et celle de leurs enfants.»

Afin d’assurer une prise en charge globale, l’équipe d’Albane Bruigom se trouve presque quotidiennement en lien avec des partenaires tels que l’Unité de médecine des violences (UMV) du CHUV, le Centre d’aide aux victimes LAVI ou le Centre d’accueil MalleyPrairie. «La responsable d’un centre d’hébergement m’a par exemple appelée ce matin pour discuter de la meilleure manière d’aider une femme. Sans jamais trahir le secret de fonction, ces échanges sont essentiels. Les victimes doivent pouvoir bénéficier d’une grande agilité de notre part pour être soignées, accompagnées psychologiquement si nécessaire et se sentir en sécurité. Ce n’est que dans ce cadre et lorsqu’elles ont toutes les clefs en main qu’elles peuvent envisager de porter plainte. Ce travail collaboratif nous permet en outre de continuer à nous améliorer sans cesse dans la détection de situations à risques.»
« Le risque zéro n’existe malheureusement pas, mais la multiplication des partenaires et donc des compétences participe d’une évolution globale positive. » — Albane Bruigom
Évaluation des risques
Lors des suivis, certains signaux peuvent alerter l’équipe de l’Unité spéciale d’un risque potentiellement élevé de féminicide pour la victime de violences domestiques. «En général, les facteurs sont multiples, mais une perte d’emploi, une interdiction de voir ses enfants ou un déséquilibre psychologique peuvent constituer des situations de fragilité qu’il ne faut pas ignorer», explique Albane Bruigom. Afin d’évaluer les risques, l’inspectrice collabore notamment avec la Cellule de gestion et de prévention de la violence (CGPV) de la police judiciaire. «Là encore, le fait de travailler ensemble nous permet d’essayer de penser à tout et de réfléchir aux solutions les plus adaptées pour protéger la victime et ses proches.»
Dans les cas où c’est un frère, une sœur, des amis ou un parent qui craignent pour l’un ou l’une de leur proche, la situation peut se révéler complexe. «En tant que policiers, il nous est difficile d’aborder une victime sans qu’il y ait eu d’intervention au préalable.» Pour les proches, le plus important consiste à ne pas couper le lien avec la personne. «De notre côté, nous allons activer différents canaux, qu’il s’agisse d’un médecin traitant ou d’un centre d’aide, par exemple, afin que la victime prenne conscience qu’elle est victime – ce qui peut prendre du temps – et qu’elle puisse ensuite venir à nous. Le risque zéro n’existe malheureusement pas, mais la multiplication des partenaires et donc des compétences participe d’une évolution globale positive en matière de prévention et de prise en charge.»
Lente prise de conscience
Sur son site, l’association Stop Feminicide rappelle que les violences envers les femmes sont encore souvent traitées comme des affaires privées, alors même qu’elles constituent le résultat de violences structurelles liées aux rapports de force patriarcaux de notre société. «Nous commençons tout juste à prendre conscience de cette réalité», indique Pierre-Antoine Hildbrand. À Lausanne, la police effectue des cours de prévention dans les classes de 5P, 8H et 10H afin de thématiser le recours à la violence dans des situations de conflits. «Les phénomènes de violence nécessitent une réponse pénale, mais ils participent également d’une certaine culture qu’il s’agit de déconstruire à plus large échelle. En ce sens, l’éducation des jeunes hommes, notamment, représente un enjeu crucial.»
« Des craintes peuvent subsister même si tout a été fait au niveau judiciaire. Certaines victimes se voient contraintes de changer de travail, de domicile, voire de canton pour se sentir pleinement en sécurité. » — Albane Bruigom
Albane Bruigom déplore pour sa part que ce soit encore presque toujours aux victimes de faire le plus de démarches pour se sortir d’une situation de violences domestiques. «Des craintes peuvent subsister même si tout a été fait au niveau judiciaire. Certaines victimes se voient contraintes de changer de travail, de domicile, voire de canton pour se sentir pleinement en sécurité, ce qui les rend paradoxalement d’autant plus vulnérables.» L’inspectrice estime que les exigences envers les auteurs restent insuffisantes: «Ils ne sont tenus d’aller qu’à une seule séance au centre de prévention de l’Ale. Des discussions sont actuellement en cours pour augmenter ces rendez-vous obligatoires à trois, mais des contrôles plus réguliers pourraient permettre de suivre plus en détail les activités de ces personnes pour prévenir d’éventuelles situations de danger.»
Au niveau de la police, Albane Bruigom, qui travaille depuis 23 ans dans la prise en charge des victimes, souhaiterait une uniformisation des connaissances et des compétences en la matière. «Cela passe par un accès à des formations continues pour tous les policiers, à l’instar de celles données sur des techniques d’intervention, par exemple. Aujourd’hui, seuls quelques policiers bénéficient de ces cours. Ma volonté et celle de mon collègue l’inspecteur Stéphane Kohler consistent à rester proactifs, afin que cela devienne obligatoire pour permettre d’améliorer la prise en charge des victimes à tous les niveaux.»
En cas d’urgence, appelez la police au 117.
Centres d’aide
- Unité spéciale pour la prise en charge des victimes (USPV) – aide.violences@lausanne.ch
- Centre d’accueil Malley Prairie, Lausanne – 021 620 76 76, non-stop
- Solidarité Femmes Bienne – 032 322 03 44
- Solidarité Femmes et Centre LAVI, Fribourg – info@sf-lavi.ch – 026 322 22 02
- AVVEC, Genève – info@avvec.ch – 022 797 10 10
- Au cœur des Grottes, Genève – 022 338 24 80 – 0840 11 01 10 (ligne d’écoute)
- Maison de Neuchâtel SAVI – savi.ne@ne.ch – 032 889 66 49
- SAVI La Chaux-de-Fonds – savi.cdf@ne.ch – 032 889 66 49